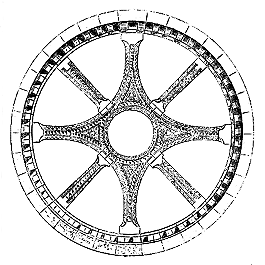Compte-rendu de la séance « Animal », Campus Condorcet, 27 Mars 2015
Archive: 13 février 2018
Cette première séance de la série d’ateliers proposés par l’IMS-Paris, qui réunissait une trentaine de participants, a eu lieu le 27 mars 2015 à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Elle a réuni Susan Crane (Columbia, NY), J. Voisenet (Univ. Toulouse), et P.-O. Dittmar (EHESS), C. Lucken (Univ. Paris 8) et s’est terminée par une visite de la Réserve où quelques manuscrits médiévaux en lien avec le thème des animaux nous ont été présentés par la conservatrice Jacqueline Artier.
Les intervenants composaient un panel d’historiens et de littéraires représentant les nouvelles manières de penser l’animal au Moyen Âge. Irène Fabry-Tehranchi (université de Reading, UK) et Fanny Madeline (CNRS) ont introduit les intervenants et ont modéré la session.
En ouverture, Jacques Voisenet qui a fait sa thèse à l’université de Toulouse II a offert une histoire et un état du champ des études sur les animaux telles qu’elles se sont faites en France depuis les années 1980, en situant son propre travail dans la continuité de ces travaux, qui n’ont cessé de reconnaître l’importance croissante des animaux quelques soient les disciplines étudiant le Moyen Âge. L’origine de ce champ remonte, selon lui, en France aux travaux sur la « zoohistoire » tels quels ceux de Robert Delors sur le commerce des fourrures médiévales et à la parution de Les Animaux ont une histoire (1984), puis de nouvelles approches se sont développées à la suite des travaux de Jacques Le Goff qui questionna notamment la relation entre l’image et le texte. Voisenet évoqua ensuite les premiers travaux des historiens qui furent surtout consacrés aux représentations de l’animal, plutôt qu’aux sources et aux origines de ces représentations. Dans le texte médiéval, les animaux étaient vus comme dociles et comme faisant partie d’un système ordonné en lien avec la genèse, il y étaient souvent décrits de manière ambivalente comme naturels ou comme des guides miraculeux vers le ciel ou l’enfer. S’appuyant sur de nombreux exemples, Voisenet évoqua les premières représentations des animaux dans l’œuvre de Dhuoda, Augustin, Isidore de Séville et les bestiaires tels que le Physiologus de Berne (Burgerbibliothek, Codex Bongarsianus 318). Chacun d’entre eux pensaient comprendre le rôle des animaux à travers des typologies, des catégorisations, des signes et des métaphores qui illustrent toujours de manière puissante à quel point les animaux colonisaient l’imaginaire médiéval. Il conclut sur le fait qu’il y avait un vocabulaire extrêmement varié associé aux animaux – métaphorique, emblématique, allégorique, représentationnel – qui se diversifia à la fin du haut Moyen Âge, reflétant l’émergence d’un nouveau système de valeurs.

Bestiaire d’Oxford. MS. Ashmole 1511, fol. 1
Christopher Lucken (Université Paris 8/Genève) prit ensuite la parole et proposa de regarder les représentation des animaux dans les fables, les exempla et les farces en prenant comme point de départ des passages d’un poème du trouvère champenois Gilles de Vieux-Maisons (nom de l’œuvre à préciser). Il parla ensuite de l’importance qu’il y avait à nommer les choses au Moyen Âge, notamment parce que, à l’instar d’Adam qui eut pour mission de nommer les créatures de Dieu, c’est une capacité de l’homme qui lui permet de se différencier des animaux, ainsi de « savoir » en nommant. Cette capacité fait écho également à la création divine et à la domination du sujet nommé. Pour Lucken, les animaux étaient conçus de trois manières différentes au Moyen Âge : comme des humains, bien que sans langage et essentiellement différents ; comme une catégorie en soi, distincte de celle des végétaux et des humains, ou alors comme des êtres complètement ignorants, sans raison, des bêtes ou des brutes. En évoquant l’influence d’Isidore de Séville, Lucken a également insisté sur la nécessité de catégoriser les animaux au cours du Moyen Âge afin de mieux comprendre la catégorie d’ « humain », et c’est en ce sens que le langage constitue un mode de distinction entre ce qui est essentiel à l’humanité en dépit du fait que l’homme peut tout aussi bien être ultimement réduit à l’état animal. Enfin, il acheva son exposé avec Aristote selon les considérations de Boèce sur le logos qui constituerait un aspect inhérent à l’expérience humaine. Lucken met ainsi en lumière la porosité des frontières entre l’homme et l’animal telle qu’elle s’exprimait dans la philosophie mais aussi dans les vers des trouvères.
Susan Crane (Columbia University) prit ensuite la parole pour évoquer le changement de paradigme qui bouleverserait actuellement le champ des Animal Studies. Citant les tendances récents de ce champ, Crane fit remarquer l’intérêt croissant, au delà des considérations symboliques et des études sur les représentations des animaux, pour une approche plus conceptuelle qui interroge les aspects éthiques, écologiques et cognitifs des animaux médiévaux. Alors que les approches classiques considéraient les humains comme des êtres distincts et supérieurs aux animaux non-humains, elle évoqua le travail de théoriciens tels que Bruno Latour (Nous n’avons jamais été modernes, 1991) qui résistent à cette conception binaire en relativisant les catégories modernes de nature/culture et humain/animal. En reprenant l’œuvre de St Augustin, Crane analysa quelques questions éthiques autour des relations humain-animal qui n’ont pas encore été explorées, affirmant que les questions littéraires et philosophiques autour de la conscience, la cognition et la souffrance animales demandent encore à être étudiées. Pour Crane, en effet, il y a beaucoup à gagner en déplaçant notre regard des figurations animales vers leurs expériences de vie et sur ce qui les rend vivant, ainsi que vers l’inscription de la dynamique humain/animal au sein des structures sociales. Pour illustrer son propos, Crane développa un exemple issu de miracles d’animaux, alors que ceux-ci sont souvent exclus des analyses, pour montrer l’une des manières par lesquelles les interactions animales sont conservées et valorisés dans les textes médiévaux à l’instar de la collection des Vie et Miracle de Ste Modwenna de Geoffrey de Burton (Oxford 2002). Sa lecture de l’histoire miraculeuse du « Loup et de la Vache » cherche ainsi à aller au delà des représentations symboliques des animaux dans leurs relations avec les humains pour comprendre les perceptions qu’avaient les hommes du Moyen Âge des comportements inter-espèces. Ainsi, Crane établit un lien entre les changements « miraculeux » du comportement des chiens, ainsi que le glissement des interactions entre chien, loup et vache, avec les techniques réelles de dressage des animaux au Moyen Âge et de domestication qui existent encore aujourd’hui.
Pierre-Olivier Dittmar (EHESS, Paris) présenta en dernier ses analyses sur l’historicité de l’animalité conçue par les historiens modernes. Il affirma ainsi que notre approche moderne est indéniablement influencée par le mouvement de naturalisation qui débute au XVIIIe siècle et qui divise l’homme et l’animal en deux catégories séparées et qui définit ultimement l’animal comme le négatif de la projection humaine. Ainsi, nous avons donc l’impression que l’animal n’a pas d’histoire. Une marmotte aujourd’hui serait la même qu’au 14e siècle. Au-delà du fait qu’il s’agit d’une perspective relativement moderne, cette idée d’animal a-historique sert également toute une série de conceptions conservatrices de la sexualité lorsqu’elle est associée aux animaux, comme par exemple : l’homme est naturellement un chasseur tandis que la femme élève naturellement la progéniture du couple. Pour aller à l’encontre de ces conceptions, Dittmar insiste sur le fait que les historiens devraient penser au-delà de ces paradigmes modernes et considérer l’anthropologie animale comme un champ offrant de grandes potentialités pour réaliser ce changement de regard. L’histoire de l’exploitation économique des animaux, par exemple, continue à rester unidimensionnelle, et il fit observer que les humains et les animaux ont rarement été étudiés ensemble dans l’anthropologie. Comme Crane, Dittmar conclut en insistant sur le fait que les historiens ont commencé à regarder au delà des analyses symboliques et des représentations animales dans le texte, mais remarque aussi le fait que les animaux constituent le parent pauvre de la recherche historique en France. Il propose de revitaliser ce sujet en l’abordant de manière plus ontologique, en les reconsidérant plutôt comme des interlocuteurs, des individus et des acteurs des diverses facettes de la société médiévale.
Rachel D. Gibson (University of Minnesota)/ trans. F. Madeline
Adam et l’astragale. Essais d’anthropologie et d’histoire sur les limites de l’humain, éd. P.-O. Dittmar avec G. Bartholeyns, T. Golsenne, M. Har-Peled et V. Jolivet, Paris, Editions de la MSH, 2009.
S. Crane, Animal Encounters. Contacts and concepts in Medieval Britain, Pennsylvania Press, 2013.
Devenir-Animal, Images Re-vues. Histoire, anthropologie et théories de l’art, 6, 2009 (www.images.revues.org/88).
L’Humain et l’animal dans la France médiévale (XIIe-XVe s.) – Human and Animal in Medieval France (12th-15th c.), éd. I. Fabry-Tehranchi et A. Russakoff, Rodopi, Amsterdam-New-York, 2014. Compte-rendu dans CRMH
.
Cette entrée a été publiée par irenefabry.