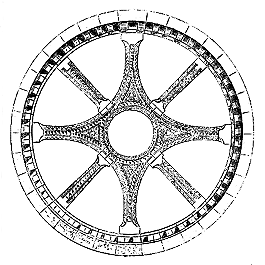Ateliers IMS, Du manuscrit à l’imprimé, 15 janvier 2016, Résumés
Archive: 14 février 2018
La transition du manuscrit à l’imprimé
Florence Bouchet (Université de Toulouse), « Du prologue (manuscrit) au discours préfaciel (imprimé) : éléments de continuité et de rupture »
L’ars artificialiter scribendi n’a pas révolutionné du jour au lendemain l’aspect et le contenu des livres. Cependant l’imprimeur ou le libraire, en tant que nouveaux acteurs dans le circuit de diffusion du livre, ont tenu à faire connaître leur « avis au lecteur ». À partir d’exemples tirés d’incunables et d’imprimés du 16e siècle, cette conférence montrera dans quelle mesure le discours préfaciel des imprimeurs/libraires a recyclé une partie du discours auctorial constitué en topique dans les prologues des manuscrits médiévaux, avant de développer des accents plus spécifiques.
Irène Fabry-Tehranchi (British Library) « Les imprimés sur vélin d’Antoine Vérard : d’Ogier le Danois au Merlin enluminé par le maître de Jacques de Besançon (1498) »
Les éditions de luxe imprimées sur vélin et enluminées tiennent une place stratégique dans la production d’Antoine Vérard, puisqu’elles lui ont notamment permis de chercher l’appui de prestigieux patrons, y compris les rois de France et d’Angleterre. Nous proposons une comparaison de l’illustration de l’édition papier courante du Merlin de 1498, avec celle de deux exemplaires enluminés dans l’atelier du maître de Jacques de Besançon, l’un de ces ouvrages ayant appartenu à la bibliothèque du roi Henry VII. Nous aborderons la question du remploi des gravures et l’examen de l’ajustement ou de la création iconographiques opérés dans les objets hybrides que constituent les ouvrages imprimés sur vélin. L’étude de différents exemplaires du Merlin de 1498 sera mise en perspective par des références à la tradition manuscrite de l’œuvre et par des comparaisons avec des imprimés sur vélin d’Ogier le Danois, également publié par Vérard la même année, un ouvrage qui, dans sa version papier, utilise plusieurs gravures également remployées dans le Merlin.
Jane H M Taylor (Durham University), « “Rondeaux, ballades, & autres telles episseries”: présence du Moyen Age dans quelques recueils lyriques de la Renaissance»
Qu’est devenue la poésie lyrique médiévale dans le monde de l’imprimerie? En 1501, pour son Jardin de Plaisance, Vérard pillait les recueils médiévaux existants pour fournir à de nouveaux lecteurs la fleur de la poésie surtout du XVe siècle, et il a été suivi par d’autres éditeurs et d’autres compilateurs convaincus, semble-t-il, que cette poésie que la Pléiade, prônant le renouvellement de la production poétique, devait plus tard déprécier, risquait tout de même de plaire à leurs lecteurs. Les Machaut, les Villon, les Charles d’Orléans ont fait les frais de l’édition tout au long du XVIe siècle – tant et si bien qu’à la toute fin du siècle, un petit rondeau de Charles d’Orléans plaisait toujours tant à Benoît Rigaud qu’il s’en est accaparé pour son Amoureux passe temps de 1582. L’indispensable Bibliographie des recueils collectifs de Frédéric Lachèvre nous permet dans une large mesure de localiser ces dernières traces de la poésie médiévale – mais comment cette poésie se lisait-elle? Dans cette communication, à partir surtout des paratextes – prologues, fictions éditoriales, juxtapositions, parfois illustrations et autres éléments scripto-visuels – je voudrais essayer de ré-imaginer la lecture que les éditeurs de la Renaissance, empruntant les restes de la poésie médiévale, préparaient à leurs lecteurs. Il s’agira bien entendu du Jardin de Plaisance, de la Chasse et départ d’amours, des Épistres de l’amant vert – mais aussi d’un certain nombre de ces recueils qui ont foisonné tout au long du XVIe siècle, tels Les Motz dorez de Pierre Grognet (1530), La Fleur de toutes joyeusetez (vers 1530), Le Recueil de tout soulas et plaisir (1552), Le Thrésor des joyeuses inventions (vers 1570).
Cette entrée a été publiée par irenefabry.